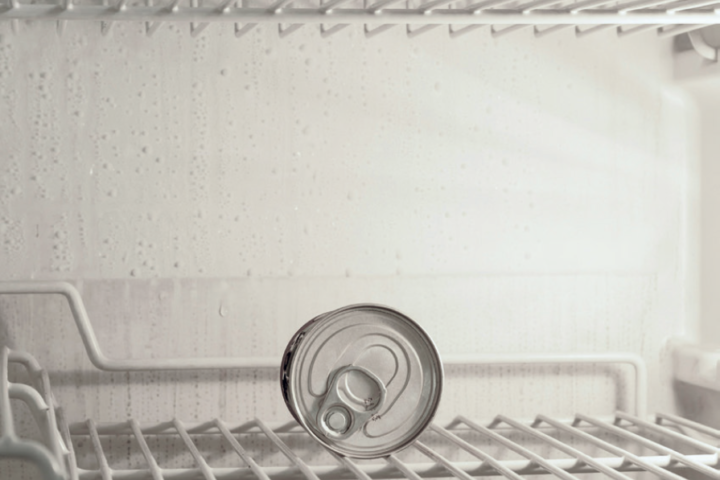Souvent perçue comme évidente autant qu’elle est fondamentale, la liberté de circuler est un droit précieux pour chacun d’entre nous. Elle nous donne l’occasion d’aller travailler chaque matin, de nous épanouir à travers des loisirs ou encore d’aller rendre visite à nos proches ou à notre famille. Ce droit essentiel est cependant remis en question par le sentiment d’insécurité que suscitent certains quartiers, par l’aménagement essentiellement masculin dans d’autres, ce qui crée des inégalités criantes entre les hommes et les femmes dans l’usage qu’ils font respectivement de l’espace urbain. Dans quelle mesure et de quelle manière les femmes occupent-elles l’espace public en 2017 ? La ville est-elle devenue une zone à risques pour elles ? Que font les autorités publiques pour les inviter à se réapproprier ce territoire ? Tentative de réponse à l’aide d’une série d’études sur le sujet.
L’année 2017 a commencé avec une nouvelle pour le moins étonnante : en 2015, seulement trois plaintes ont été déposées pour des faits de harcèlement de rue (statistiques policières concernant la « Zone Midi » de la région Bruxelles-Capitale). Un chiffre extrêmement bas malgré l’avènement en 2014 de la « loi sexisme » dont le but est de lutter contre le sexisme au sein de l’espace public. En cause : la difficulté à prouver un geste ou un comportement méprisant fondé sur la notion de sexe. Dans ce genre de cas, les faits doivent en effet être appuyés par des traces écrites, voire des images ou des vidéos capturées à l’aide d’un téléphone portable. Les personnes ciblées par ces faits de harcèlement étant en outre réticentes à déposer plainte, les témoignages en la matière se font très rares. Pourtant, ces actes sont punis par la loi. Pour un délit de ce type, l’auteur encourt un mois à un an d’emprisonnement ainsi qu’une amende de 50 à 1.000 euros.
Face à ce taux de plaintes extrêmement faible, faut-il conclure à l’inutilité de la « loi sexisme » ? Ou du moins à l’impossibilité de son application ? Après le buzz politique en faveur de Joëlle Milquet (CDH) – Ministre de l’Intérieur en charge de l’Égalité des chances à l’époque – qui avait fait adopter la loi le 22 mai 2014, force est de constater que celle-ci n’apporte que peu, voire pas de protection effective aux femmes qui se déplacent dans la sphère publique. Une exposition à des dangers divers et variés qui n’est pas sans conséquence sur leur façon d’occuper le territoire.
Des usages sexués de l’espace urbain
À l’aube des années 1990, des travaux anglo-saxons féministes révélaient déjà que les appréhensions des femmes à circuler dans l’espace public limitaient leur usage de ce dernier. Même si elles s’investissent davantage dans leur quartier, il apparaît que les femmes sont minoritaires dans certains lieux publics [1]. C’est surtout lorsque la nuit tombe qu’elles évitent l’espace urbain qu’elles considèrent, à tort ou à raison, comme dangereux. Malgré ces chiffres, le public féminin constitue 70% des utilisateurs des transports en commun et 90% des personnes qui subissent des violences sexuelles dans l’espace public.
En 2011, une enquête [2] a mis au jour l’écart entre les hommes et les femmes face au sentiment d’insécurité dans les transports en commun en région parisienne. Selon ses résultats, 58,7% des femmes auraient peur dans les transports en commun, contre 30,7% des hommes. La réalité montre pourtant que ce sont les jeunes hommes qui sont les plus exposés aux actes de violence dans l’espace public. Mais les femmes vivent un autre type d’expérience : elles sont quatre fois plus souvent confrontées à des remarques sexualisées, des regards irrespectueux, des attouchements ou des attitudes à caractère intimidant (filature…).
Cette crainte d’être interpellée peut s’exprimer de différentes manières chez les femmes : évitement de certains lieux, port de vêtements les moins féminins possibles, déplacements en groupe, sorties ou courses faites en journée plutôt que le soir, trajets réalisés en taxi ou avec sa voiture personnelle… Les femmes âgées de 65 ans et + appartiennent à la catégorie d’âge et de sexe qui manifeste le plus grand sentiment d’insécurité : plus que les autres, elles se sentent souvent exposées à un danger et surtout incapables de pouvoir y répondre. Mais, au-delà de cette « vulnérabilité féminine » potentielle qu’on peut retrouver chez certains types de publics, il convient de rappeler les déplacements fragmentés – et donc plus à risques – que réalisent les femmes au sein du tissu urbain : elles emmènent les enfants à l’école, empruntent les transports en commun pour aller au travail et fréquentent souvent les commerces avant de regagner leur domicile. Les hommes eux, passent souvent directement du domicile à la voiture pour se rendre au travail.
Une participation citoyenne limitée
Dans des villes où les femmes se déplacent toujours dans l’espace public pour y faire une action précise (emmener le petit dernier à la garderie, faire des courses…), elles se donnent rarement rendez-vous pour y flâner ou pour y stationner, sauf quand il s’agit de surveiller les enfants au parc. Un constat interpellant qui corrobore les recherches menées en Gender Mainstreaming [3] : pour 1 euro investi en faveur des femmes dans les équipements de loisirs, jusqu’à 3 euros le sont pour les hommes. En termes de mètres carrés, les garçons « consomment » jusqu’à neuf fois plus de surface urbaine que les filles. Ces inégalités sont implicitement construites par des modes de gestion d’une ville faite « par et pour les hommes »[4]. 
Un manque d’investissement en faveur des femmes au sein de la sphère publique engendre une kyrielle de conséquences : en plus de voir leur mobilité limitée, la gent féminine est également restreinte dans sa participation à la vie de la cité, sans parler de l’impact économique et social que cette sous-mobilité peut induire. Heureusement, d’autres études montrent qu’un aménagement urbanistique pensé selon les spécificités de genre favorise la mixité dans l’espace public. Mettre à disposition des toilettes publiques plutôt que des urinoirs ; créer des parcs plutôt que des terrains de football sont quelques exemples d’aménagement urbanistique qui influencent l’utilisation que nous faisons de la ville, mais qui illustrent également l’importance des choix – conscients ou pas – faits par les autorités compétentes.
Focus sur quelques initiatives prometteuses
Les marches exploratoires
Nées à Toronto à l’initiative de groupes de femmes en 1989, les marches exploratoires existent désormais dans le monde entier, notamment chez nous. Leur but ? Analyser la manière dont l’espace public est construit, pensé, pour mieux, in fine, pouvoir se l’approprier. En regardant un quartier donné avec attention et en identifiant ce qui peut poser problème (trottoirs étroits ou dégradés, ruelles mal éclairées, absence de bancs publics…) pour la gent féminine, les « exploratrices » sont plus à même de pouvoir formuler des pistes d’amélioration concrètes aux autorités publiques. Chaque marche est guidée par une méthodologie décidée à l’avance pour permettre aux participantes d’explorer leurs ressentis via des exercices de perception : qu’entend-on ? Qu’estce que je ressens ? Est-ce agréable de marcher ici ? Serais-je à l’aise d’attendre quelqu’un à cet endroit ? Autant d’interrogations qui permettent de mettre des mots sur des sentiments qui étaient encore inconscients jusque-là. Le pas est volontairement lent afin de pouvoir relever des « anomalies » qu’on ne verrait pas habituellement. L’objectif, en bout de course : améliorer le lieu en question pour y (re)faire venir les types de publics qui l’évitaient pour des raisons de sécurité, de salubrité, de malaise…
Les politiques Gender Mainstreaming
Si Montréal a tenu compte des marches exploratoires pour modifier son urbanisme et rendre la ville plus agréable aux femmes, Vienne est devenue la référence en la matière. La capitale autrichienne fait en effet office de pionnière en pratiquant le Gender Mainstreaming, c’est-à-dire que, dès la conception des projets, elle passe l’activité de chacun de ses services au crible de l’impact sur le genre. Selon le Conseil Wallon de l’Égalité entre Hommes et Femmes (CWEHF), le Gender Mainstreaming, revient à « mettre en place une stratégie qui a pour ambition de renforcer l’égalité des femmes et des hommes dans la société, en tenant compte des différences socialement construites, notamment socioéconomiques, entre la situation des femmes et des hommes, ainsi que de leur impact potentiel dans tous les domaines et à chaque étape des processus politiques – élaboration de lois et mesures, mise en œuvre (évaluation ex ante), suivi et évaluation (évaluation ex post) [5]». Depuis mars 2012, la Région bruxelloise a inclus une dimension du genre dans les politiques régionales, notamment en matière d’urbanisme et de mobilité. En Wallonie, c’est en mars 2015 que Maxime Prévot, ancien Ministre wallon de l’Action sociale, de l’Égalité des chances et des Droits des Femmes, a présenté le 1er Plan wallon Gender Mainstreaming, autrement appelé le « Plan Genres », pour plus d’égalité entre les hommes et les femmes dans les politiques wallonnes.

L’animation « Touche Pas A Ma Pote » en classe
« Touche Pas A Ma Pote », c’est le nom d’une campagne de harcèlement lancée par le magazine ELLE Belgique en 2012. Initiée en réaction au court métrage « Femme de la rue » de Sofie Peeters qui se faisait siffler et interpeller à tout bout de champ dans le quartier Anneessens (Bruxelles), la campagne « Touche Pas A Ma Pote » est devenue, forte de son succès, une association. En collaboration avec la Ligue d’Impro, TPAMP propose l’animation « Touche Pas A Ma Pote En Classe », une animation éducative d’impro théâtrale qui a pour but de sensibiliser et de conscientiser les jeunes au harcèlement de rue et au sexisme quotidien. L’an dernier, près de 90 écoles primaires et secondaires ont accueilli cette animation originale, avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Le pitch : trois comédiens de la Ligue d’Impro jouent devant une ou plusieurs classes, trois courtes scènes illustrant des situations de discriminations sexistes et de harcèlement de rue. Au bout de quelques minutes, un des comédiens arrête la scène et suscite les réactions des élèves. Commence alors un débat entre l’ « animateur » et les membres de l’audience qui sont amenés à agir comme des metteurs en scène sur le comportement des protagonistes, jusqu’à ce que la situation conflictuelle trouve une résolution. Ce sont donc les jeunes qui font émerger une forme de morale, et non les adultes. Page Facebook du projet : www.facebook. com/touchepasamapoteenclasse
Des transports 100% féminins [6]
Notre globe fourmille de villes qui ont décidé de développer des transports exclusivement féminins afin de lutter contre le harcèlement sexuel et les attitudes sexistes. À Tokyo, Le Caire, Brasilia et Rio de Janeiro, des rames de métro pelliculées de rose ont été mises en service principalement aux heures de pointe. En Thaïlande et au Mexique, ce sont des bus « solo para damas » (« exclusivement pour les femmes » en espagnol) qui ont été lancés en 2008. Depuis 2006, les Pink Ladies Cabs ont vu le jour à Londres et proposent un service de taxis où les femmes chauffeuses transportent uniquement leurs semblables. Depuis lors, ce service est disponible dans de nombreuses autres métropoles comme Dubaï, Moscou, New York, New Delhi… En Allemagne, à l’aéroport de Francfort plus précisément, l’année 2015 a vu naître des places de parking strictement réservées aux femmes. Plus larges, plus proches des sorties, peintes en rose et indiquées par un panneau assorti d’une fleur, ces emplacements n’ont pas manqué de susciter la polémique, même si elles existent depuis les années 1990 dans tout le pays. En effet, depuis cette date, l’ensemble des parkings publics doit être doté d’au moins 5% de places de ce type.
INTERVIEW
Apolline VRANKEN, Présidente du Cercle Féministe de l’ULB
Avec 87 membres à l’heure actuelle – dont 10% d’hommes – le Cercle Féministe de l’ULB (CFULB) est un cercle politique qui a vu le jour en 2013 sous l’impulsion de trois étudiantes. Parce que les femmes subissent l’essentiel des viols, des violences conjugales, du harcèlement dans l’espace public et au travail, qu’elles restent payées 25% de moins qu’un homme et qu’elles obtiennent les emplois les plus précaires, le CFULB entend agir comme groupe de pression à l’ULB pour défendre les intérêts des femmes de la communauté universitaire qui connaissent des stigmatisations, violences, ou fragilités. Rencontre avec Apolline Vranken, sa présidente.
Est-ce difficile de sensibiliser au sexisme, au harcèlement de rue à notre époque ?
Oui, c’est difficile. Le sexisme est pour beaucoup de personnes profondément intégré dans leur éducation et leurs comportements. De nombreux discours, qu’ils soient politiques ou publics, tentent de discréditer les expériences, les témoignages et les paroles des femmes. Le sexisme est banalisé et minimisé. Il est insidieux. Le sexisme peut prendre bien des formes : sexisme ordinaire, discrimination à l’emploi, harcèlement de rue, violences, féminicides (meurtres de femmes NDLR), etc. Il est important de lutter contre toutes ces formes de sexisme et de faire comprendre à tous et toutes, la gravité de celles-ci.
Pour un groupe de pression féministe, n’est-ce pas un peu paradoxal de compter des membres masculins ?
Il n’y a selon moi aucun paradoxe dans cette réalité. 10% de nos membres actifs sont effectivement des hommes et derrière 25% des « likes » de notre page Facebook, on trouve des hommes. Cela peut tout et rien dire. Je trouve cela génial d’avoir leur soutien en tant qu’alliés mais leur nombre (faible ou élevé) ne donne ou n’enlève en rien de la légitimité aux féminismes car il existe selon moi une multitude de féminismes, de militantismes, de théories et de méthodes.
Par quels biais promouvez-vous et diffusez-vous le féminisme au sein du Campus de la Plaine ?
Comme je le disais, il existe une multitude de féminismes, de militantismes, de théories, de méthodes et d’outils. Le Cercle féministe de l’ULB vise la promotion et la diffusion des féminismes via la réflexion sur le sexisme, la discussion et l’action. Cela passe par des réunions hebdomadaires, des conférences, des tables de discussion, des projections, des sorties culturelles, des manifestations, des ateliers d’autodéfense, du partage de contenus sur les réseaux sociaux… Il nous semble primordial de créer des espaces de déconstruction, d’écoute et de parole pour les personnes concernées.
Est-ce un combat difficile, de longue haleine ?
C’est un combat difficile car complexe et systémique. Les discriminations systémiques fondées sur les genres sont induites par le système social dans lequel nous vivons et ce dernier est patriarcal. À titre d’exemple, le Forum économique mondial publiait en octobre 2016 un rapport selon lequel l’égalité salariale femmes-hommes ne serait pas atteinte avant 170 ans, soit en 2186 [7]…
Notre époque est-elle difficile pour les (jeunes) femmes d’aujourd’hui ?
En Belgique, le vécu d’une femme cisgenre [8] hétérosexuelle blanche n’est évidemment pas le même que celui des femmes racisées [9], voilées, transgenres ou lesbiennes, etc. Notre époque est difficile globalement pour les femmes mais l’est d’autant plus pour celles qui subissent simultanément différentes formes de discriminations.
Plus qu’avant ? Si oui, dans quelle mesure ?
Évidemment les choses bougent et avancent mais pas encore assez vite. Au niveau du gouvernement belge par exemple, la loi du Gender Mainstreaming [10] qui vise à se soucier de l’impact de chaque nouvelle loi sur l’égalité femmes-hommes a été votée en 2015.
En 2016, le projet de loi Peeters touchait clairement les femmes en les précarisant d’autant plus avec des heures supplémentaires sans sursalaire, des semaines de travail jusqu’à 45h, des contrats intérim à durée indéterminée, des contrats zéro heure, la réduction ou la suppression du complément chômage, un horaire connu à peine 24h à l’avance, le travail de nuit à partir de 22h seulement, etc. Pour un pas en avant, deux pas en arrière. C’est la raison pour laquelle les combats féministes sont toujours une nécessité.
Annabelle Duaut
Notes et bibliographie
[1] Espace-vie n°269, mars 2017
[2] « Victimation et sentiment d’insécurité en Ile-de-France », Institut d’Aménagement et d’Urbanisme, 2011.
[3] Voir notre définition ci-dessous
[4] http://www.pavillon-namur.be/sites/default/ files/20140509_expo_la_ville_une_affaire_dhommes.pdf
[5] https://cwehf.be/2016/03/11/gender-mainstreaming-en-wallonie-patience-on-y-travaille/
[6] Même si cette initiative est une alternative à un problème réel, des transports unisexes restent une forme de retour en arrière pour l’égalité homme femme et la liberté, ce que nous déplorons à LBW.
[7] http://www.huffingtonpost.fr/2016/10/26/legalite-professionnelle-hommes-femmes-pas-avant-2186-selon/
[8] Dans les études de genre, cisgenre décrit un type d’identité de genre où le genre ressenti d’une personne correspond au genre qui lui a été assigné à la naissance. Le terme est construit par opposition à celui de transgenre, pour une personne qui remet en question le genre qui lui a été assigné.
[9] Personne victime de racisation, c’est-à-dire du fait d’être assimilée à une race humaine.
[10] Voir notre définition plus haut