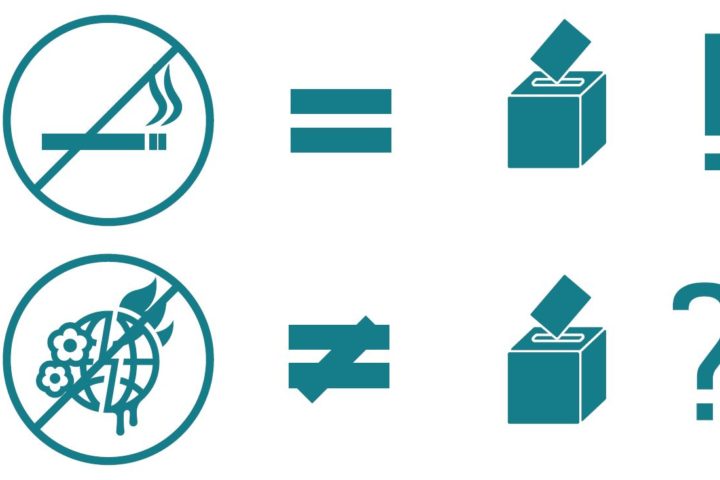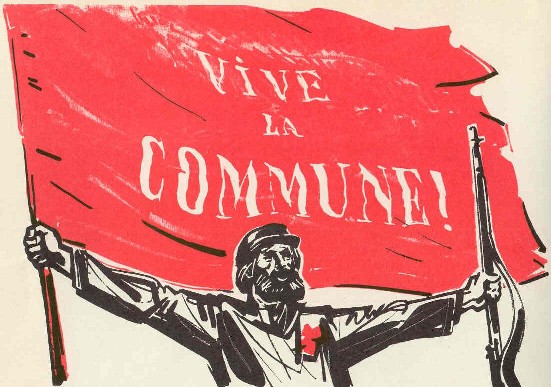Mehdi Toukabri
En 2016, Donald Trump fait irruption dans la course à la présidence américaine comme un outsider haut en couleur, souvent moqué, rarement pris au sérieux. Pourtant, presque dix ans plus tard, l’ancien promoteur immobilier a laissé une empreinte profonde dans la politique américaine. Son slogan de campagne, « Make America Great Again » (MAGA), a cessé d’être une simple accroche populiste pour devenir le coeur d’une idéologie composite, cohérente et durable, comme l’explique le politologue Jérôme Jamin dans son dernier ouvrage Make America Great Again, naissance d’une idéologie (éditions Liberté j’écris ton nom). Professeur à l’Université de Liège, spécialiste des États-Unis, il propose dans cette analyse un fil rouge historique et intellectuel reliant Trump à des courants bien plus anciens. MAGA n’est pas une création ex nihilo. C’est un agencement habile de thèses marginales devenues, par les circonstances, dominantes.
L’idéologie MAGA : un patchwork cohérent aux racines anciennes
 Dans l’imaginaire européen, le populisme de Trump paraît nouveau, brut et sans racines. Erreur, selon Jamin. Le populisme est aussi vieux que la République américaine elle-même. Dès la fin du XVIIIe siècle, les tensions entre les élites urbaines fédéralistes et les classes rurales se cristallisent dans une rhétorique du « peuple contre les élites ». Ce schéma traverse l’histoire américaine : du People’s Party à la fin du XIXe siècle, progressiste et inclusif, jusqu’à des figures plus controversées comme Ross Perot ou Pat Buchanan, qui préfigurent Trump en défendant un protectionnisme dur, un rejet de l’immigration assumé, le tout auréolé d’un repli identitaire. Trump ne fait que réactiver ces thèmes, mais avec un flair hors du commun. Il reprend notamment les thèses du nativisme, une idéologie qui promeut une Amérique blanche, chrétienne et d’héritage européen, au détriment des minorités et des immigrants récents. Pat Buchanan, candidat aux élections présidentielles des années 1990, fut l’une de ses principales inspirations. À l’époque, son discours faisait encore figure de marginalité. Avec Trump, il trouve sa masse critique. Contrairement à ce que certains pensent, Trump n’a presque rien inventé. Il a su combiner :
Dans l’imaginaire européen, le populisme de Trump paraît nouveau, brut et sans racines. Erreur, selon Jamin. Le populisme est aussi vieux que la République américaine elle-même. Dès la fin du XVIIIe siècle, les tensions entre les élites urbaines fédéralistes et les classes rurales se cristallisent dans une rhétorique du « peuple contre les élites ». Ce schéma traverse l’histoire américaine : du People’s Party à la fin du XIXe siècle, progressiste et inclusif, jusqu’à des figures plus controversées comme Ross Perot ou Pat Buchanan, qui préfigurent Trump en défendant un protectionnisme dur, un rejet de l’immigration assumé, le tout auréolé d’un repli identitaire. Trump ne fait que réactiver ces thèmes, mais avec un flair hors du commun. Il reprend notamment les thèses du nativisme, une idéologie qui promeut une Amérique blanche, chrétienne et d’héritage européen, au détriment des minorités et des immigrants récents. Pat Buchanan, candidat aux élections présidentielles des années 1990, fut l’une de ses principales inspirations. À l’époque, son discours faisait encore figure de marginalité. Avec Trump, il trouve sa masse critique. Contrairement à ce que certains pensent, Trump n’a presque rien inventé. Il a su combiner :
- le rejet de l’État fédéral (hérité de Reagan),
- le nationalisme économique (inspiré du Tea Party),
- la crainte du multiculturalisme (relue à la lumière du nativisme),
- et un messianisme religieux évangélique.
Ce montage idéologique, note Jamin, devient cohérent au fil du temps. L’imprévisibilité de Trump masque en réalité une constance thématique : immigration, religion, pouvoir d’achat, rejet des élites.
Même le slogan « Make America Great Again » est une reprise directe de Ronald Reagan qui, en 1980, parlait déjà de « Let’s make America again ». Ce que Trump réussit, c’est de fusionner ces influences en une matrice politique inédite.
Polarisation et État de droit sous tension
Mais cette matrice se déploie dans une Amérique profondément fracturée. Depuis les années Clinton, la polarisation entre démocrates et républicains n’a cessé de s’accentuer. Avec l’émergence de Fox News dans les années 1990, puis des réseaux sociaux, l’opinion publique s’est divisée en bulles informationnelles hermétiques. Chacun regarde « ses » médias, ne fréquente plus les opinions opposées et perçoit l’autre camp comme un danger.
Cette polarisation s’est accélérée sous Barack Obama, dont l’élection a agi comme un choc symbolique pour une partie de la population blanche conservatrice. Le Tea Party2 est né de cette réaction, habillée d’arguments économiques, mais souvent traversée de sous-entendus raciaux. C’est sur ce terreau que Trump bâtit son succès, en captant une base électorale frustrée, prête à rompre avec les institutions traditionnelles du Parti républicain.
Depuis son élection, puis durant son mandat, Trump a enchaîné les controverses : attaques contre les médias, décisions contestées sur l’immigration, usage discutable de la force fédérale, tentatives d’entrave à la justice. L’objectif, selon l’analyse de Jamin, est clair : « inonder la zone de chaos » pour empêcher l’opposition de riposter efficacement. Une stratégie théorisée par son ancien conseiller Steve Bannon.
Mais le système américain tient bon, pour l’instant. La séparation des pouvoirs fonctionne, les cours de justice bloquent ou corrigent certaines décisions, et même la Cour suprême, pourtant majoritairement nommée par Trump, ne se montre pas systématiquement docile. « Il fait beaucoup de bruit, mais le système judiciaire l’encadre encore », résume Jamin. Reste que les dégâts sont là : raids médiatisés contre les migrants, tensions dans les rues, méfiance généralisée envers les institutions…
 Et l’Europe dans tout ça ?
Et l’Europe dans tout ça ?
L’Europe, quant à elle, n’a certainement aucunes leçons à donner. La progression des droites radicales, les attaques contre les juges, les discours anti-migrants… Tout cela trouve des échos en Belgique, en France, en Italie ou en Hongrie. Le modèle MAGA a fait école.
Pour Jérôme Jamin, le danger est réel, mais tout n’est pas perdu. Le Congrès américain montre des signes d’autonomie croissante. Même dans son propre camp, des voix républicaines s’élèvent. Et le système de freins et contrepoids (checks and balances) – fondement de la Constitution américaine – continue de produire ses effets.
Mais le salut, à ses yeux, passera aussi par la capacité des démocrates à proposer un projet cohérent et une figure charismatique pour incarner une alternative. Pour l’heure, ce sursaut tarde à venir.
Comprendre pour résister
Dans son ouvrage, Jamin consacre enfin un chapitre pédagogique essentiel pour mieux appréhender le fonctionnement du système américain : pouvoir du Congrès, portée réelle des décrets exécutifs, signification du shutdown… Des rappels bienvenus pour éviter les contresens dans un débat souvent émotionnel et mal informé. Make America Great Again, naissance d’une idéologie n’est pas un réquisitoire. C’est un diagnostic rigoureux d’une évolution politique majeure. Une invitation à regarder en face les dérives du populisme et à réfléchir à la meilleure manière d’y répondre – des deux côtés de l’Atlantique.
Sources :
1 Cet article est basé sur l’émission Libre, Ensemble du 21 juin 2025 « Make America Great Again, naissance d’une idéologie », disponible sur :
www.laicite.be/emission/make-america-great-again-naissance-dune-ideologie/
2 Le Tea Party est un mouvement politique aux États-Unis, contestataire, de type libertarien, qui s’oppose à la croissance de l’État fédéral et de ses impôts. Il émerge au début de la présidence Obama, dans le contexte de la crise économique de 2008-2010 liée à la crise financière.