Mehdi Toukabri
Malgré une seconde place de la Belgique au classement Rainbow Map d’Ilga-Europe, l’association faîtière des associations européennes LGBTQIA+, des zones d’ombre par rapport aux droits des personnes issues de ces communautés subsistent. La prise en charge de jeunes délinquants se disant LGBTQIA+ en fait partie, surtout lorsque ceux-ci sont mineurs. Nolan Masure constate que cette prise en charge est proche de l’inexistence. Seules les actions isolées de certains encadrants permettent de pallier le mieux à cette inaction institutionnelle.
Interview de Nolan Masure, conseiller laïque1 à l’IPPJ de Wauthier-Braine et doctorant en sociologie.

Comment sont pris en charge les jeunes qui se déclarent LGBTQIA+, en IPPJ ?
Nolan Masure : Il n’y a aucune prise en charge particulière qui est mise en avant en IPPJ pour les jeunes issus de la communauté LGBTQIA+. Ceci est très problématique. Ils sont reçus, en fait, comme tout autre jeune. Son orientation sexuelle ne change en rien sa prise en charge. Ce qui peut poser des problèmes car nous sommes au sein d’un lieu où les jeunes sont marginalisés.
Certains adultes encadrants, au sein de l’institution, ont, encore aujourd’hui, un fonctionnement, ainsi qu’une idée assez “masculiniste” de l’enfermement. Cela a une conséquence claire : une répercussion de préjugés à l’encontre de l’orientation sexuelle ou du genre des jeunes qui souhaitent en parler.
Finalement, je dirais que j’ai plutôt un avis négatif sur la prise en charge des jeunes LGBTQIA+ en IPPJ.
Qu’est-ce qu’il faudrait, dès lors, mettre en place pour que ces jeunes soient mieux pris en charge ?
NM : La première chose, à mon sens primordiale, serait d’établir une personne de confiance par section. Il faut savoir que les IPPJ sont divisées en plusieurs sections (d’environ 10 jeunes par section, NDLR) classées selon la gravité des faits reprochés aux jeunes. Dans chacune d’elle, il serait nécessaire qu’une personne de confiance et qualifiée, par exemple un éducateur spécialisé ou un assistant social formé sur les questions d’orientation sexuelle et de genre, soit présente et à disposition des jeunes. Cela permettrait une meilleure prise en charge concernant les problématiques liées à l’orientation sexuelle ou le genre. Ensuite, une deuxième solution, plus structurelle, serait de former et informer, les encadrants sur les bonnes pratiques concernant l’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (EVRAS).
Justement, par rapport à l’EVRAS, c’est un peu l’angle mort éducatif en IPPJ. On ne sait pas si c’est obligatoire ou pas. Résultat : c’est qu’il n’y a pas d’EVRAS proposée aux jeunes de manière structurelle. Elle est plutôt laissée au bon vouloir des formateurs. A l’IPPJ de Wauthier-Braine, une formatrice donne le cours d’EVRAS, mais seulement à deux sections sur les cinq. Donc, trois sections n’ont tout simplement pas de cours d’EVRAS. C’est extrêmement problématique car, ce sont précisément des espaces de paroles destinés à ce que les questions de genre et d’orientation sexuelle soient abordés.
Enfin, tant que la structure des IPPJ, c’est-à-dire l’administration générale de l’aide à la jeunesse n’imposera pas une certaine prise en charge des jeunes (dans ce cas-ci, donner des cours d’EVRAS, NDLR), les travailleurs sociaux, déjà surchargés, ne pourront malheureusement pas le faire d’eux-mêmes.
Pourquoi est-ce que le cours d’EVRAS n’est pas obligatoire en IPPJ comme dans toutes les autres structures scolaires ? Pourquoi est-ce une exception ?
NM : Il y a plusieurs aspects. L’IPPJ, c’est un véritable imbroglio institutionnel. D’abord, l’institution n’est pas un établissement scolaire. C’est-à-dire qu’elle répond à des règles très spécifiques concernant l’aide à la jeunesse, la protection de la jeunesse et non avec l’enseignement.
L’IPPJ répond, en fait, à des réalités de terrain très spécifiques. Si l’on prend les réalités vécues par les jeunes concernant, par exemple, l’orientation sexuelle ou le genre, comme je le disais précédemment, pratiquement aucune prise en charge n’est proposée. Je dirais qu’en plus, un certain tabou entoure cette question.
Par rapport à la non obligation du cours d’EVRAS en IPPJ, aucun texte officiel n’estampille clairement le fait que l’EVRAS est censé être obligatoire en IPPJ. Certains de mes collègues disent qu’il y aurait une impulsion de l’administration générale de l’aide à la jeunesse incitant les IPPJ à proposer aux jeunes des cours d’EVRAS obligatoires. Mais dans les faits, sur le terrain, pas de cours d’EVRAS. Evidemment, je ne parle que de la situation de l’IPPJ dans laquelle je travaille. Je ne peux pas me prononcer pour les autres. Finalement, la réalité reste très floue et disparate.
Au sein de votre article dans Espace de Libertés2, vous mentionnez le fait qu’il y aurait une prédominance du virilisme au sein des IPPJ, tant au niveau des encadrants qu’au niveau des jeunes. Comment gère-t-on cela en tant que conseiller laïque en IPPJ ? Comment est-ce que vous tentez, tout de même, d’apporter une aide aux personnes LGBTQIA+, malgré cette prédominance viriliste ?
NM : En tant que conseiller laïque, nous ne serons toujours que des pansements pour les jeunes LGBTQIA+. Il faut savoir qu’en tant que conseiller moral (musulman, catholique ou laïque) au sein des IPPJ, nous oeuvrons pour que ces personnes soient accueillies au mieux. Lorsque je parlais précédemment de la nécessité d’une personne de confiance par section, pour le moment, ce rôle, nous l’endossons, en fait, en tant que conseillers moraux.
En tout cas, au sein de mon IPPJ et je parle d’expérience, les jeunes de la communauté LGBTQIA+ se tournent directement vers moi. Je pense également que mes collègues les redirigent également vers moi. Pourquoi ? J’ai appris, il y a peu, par exemple, que certains jeunes sont très mal à l’aise à l’idée de discuter des questions de genre et d’orientation sexuelle avec les éducateurs. Je genre volontairement le fait de dire « éducateurs », parce que les éducatrices, elles, connaissent moins ce problème. Dans les faits, certains éducateurs ont, par exemple, un problème avec la question de l’homosexualité. Ils ont du mal à gérer cela. Ce sont des questions qui les mettent mal à l’aise et vous imaginez, dès lors, le malaise lorsqu’un jeune souhaite précisément discuter de cette thématique particulière. Donc, je dirais qu’il y a un véritable travail de déconstruction à réaliser dans le chef de l’équipe éducative. Surtout masculine.
Ensuite, les IPPJ sont des lieux très virilistes. Historiquement, elles sont issues des prisons. Petit à petit, elles s’en sont détachées afin de ressembler à ce que nous connaissons aujourd’hui. Désormais, c’est un vrai projet de réinsertion sociale et éducatif. Néanmoins, l’IPPJ n’est mixte, au niveau des encadrants et encadrantes, que depuis une vingtaine d’années, tout au plus. Donc, il y a encore une trace très perceptible de virilité au sein de l’IPPJ. Avec cette tradition carcérale, certains matons d’hier sont devenus surveillants en IPPJ. Certains éducateurs ont aussi fait la transition des Centres fédéraux aux IPPJ. Avec, et cela coule de source, un aspect moins pédagogique et plus « sécuritaire ». Il subsiste toujours une petite tradition, une petite culture viriliste qui s’est perpétuée jusqu’aux IPPJ actuelles. On retrouve vraiment cet ADN qui est encore présent, surtout lorsqu’on entend les éducateurs les plus âgés parler avec beaucoup de nostalgie « de l’ancien temps ou de l’âge d’or de l’institution ». Certains éducateurs peuvent, aussi, être choqués lorsque deux éducatrices sont ensemble en section, sans homme. Cela m’est arrivé qu’ils me demandent : « comment vont-elles se défendre ? Comment vont-elles rendre les coups en cas de bagarre ? » C’est déjà un premier cadre très viriliste.
On peut également parler des autres jeunes non-LGBTQIA+. Personnellement, je suis assez fier. J’observe, de manière générale, que lorsqu’une personne LGBTQIA+ arrive en IPPJ, elle n’est, finalement, pas si maltraitée par les autres jeunes. Bien sûr, il y a des remarques, mais elles viennent principalement des adultes encadrants. J’ai pu, par exemple, entendre certains encadrants, bon nombre de fois, insulter un jeune de “PD”, alors que celui-ci n’est pas nécessairement homosexuel. Au même titre, les jeunes s’insultent par le biais de mots à consonnance homophobe afin de se rabaisser. Cette situation, très courante, peut être très mal vécue par les personnes LGBTQIA+.
Mais, de manière générale, la situation aurait pu être pire que celle à quoi je m’attendais, au vu des milieux, assez marginaux et virilistes, desquels sont issus les jeunes. Au final, ils sont assez déconstruits sur la question. Certains mettent même le holà lorsqu’une situation homophobe ou transphobe arrive. Cela amène un peu de maturité et de calme au sein des sections. C’est assez similaire chez les adultes. Tout n’est pas noir. Il y a beaucoup d’éducatrices qui encadrent, en général, très bien ces situations-là. Mieux que les hommes, à vrai dire.
Est-ce que les IPPJ sont l’angle mort des politiques d’inclusion ?
NM : Je ne dirais pas cela. Déjà parce que le délégué général aux droits de l’enfant a tout de même réalisé une très chouette campagne sur les questions concernant la transidentité, l’inclusion, le genre et les orientations sexuelles au sein des IPPJ3 ou des centres de privation de liberté pour les jeunes. Par contre, le véritable angle mort des politiques d’inclusion n’est pas l’IPPJ, mais bien, de manière générale, l’aide à la jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles. Les jeunes de la communauté LGBTQIA+ envoyés en IPPJ arrivent, pour la plupart, souvent d’un internat ou d’un autre centre. Ils ont vécu des violences. Ils sont aussi dans une désinformation par rapport à ce qu’ils ou elles sont.
Par exemple, les personnes trans sont placées selon leur genre dans une IPPJ pour garçons ou pour filles. Le choix est entièrement laissé à l’appréciation du juge. Là, il y a un vrai angle mort. C’est-à-dire qu’un juge peut décider de placer une personne transgenre ayant fait sa transition pour devenir une femme en IPPJ pour femme, mais peut aussi la placer dans une autre IPPJ pour garçon, selon ce qu’il pense être le mieux pour elle.
N’est-ce pas là de la discrimination si tous les citoyens ne sont pas mis sur un pied d’égalité ?
NM : C’est clairement discriminatoire pour les jeunes trans en tout cas.
Êtes-vous optimiste par rapport au futur de la prise en charge des jeunes issus de la communauté LGBTQA+ en IPPJ ?
NM : Je suis d’un naturel pessimiste, mais pour l’occasion, je vais dire optimiste. Malgré mes constatations, assez négatives je dois le dire, du positif est tout de même à noter. Il faut voir cela sous le prisme historique et culturel. En 20 ans, un progrès faramineux s’est établi dans la prise en charge de ces personnes LGBTQIA+ au sein de la société. C’est quelque chose qui prend du temps. Il faudrait aller encore plus vite, mais je pense que d’ici une quinzaine d’années, on sera déjà impressionné dans le bon sens par rapport aux avancées futures. Cependant, il est important de noter que cela ne va pas assez vite. Nous sommes en train de perdre beaucoup de jeunes en chemin. Cela crée des dégâts incommensurables à une jeunesse en quête d’identité qui ne
demande qu’à être acceptée pour ce qu’elle est. Donc, restons optimistes, mais poursuivons le travail, tout simplement.
Dans l’actualité du mouvement :
Intervention victorieuse du Centre d’Action Laïque à la Cour constitutionnelle
Dans un nouvel arrêt ne souffrant d’aucune ambiguïté, la Cour constitutionnelle, une des plus hautes juridictions du pays et pilier de nos valeurs démocratiques, a statué sur les différents recours introduits par des associations opposées à la généralisation de l’EVRAS (éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle) et les a tous rejetés. Le Centre d’Action Laïque est intervenu4 en soutien à la Fédération Wallonie-Bruxelles, à la COCOF et à la Région wallonne, parties défenderesses.
Une défaite pour les opposants à l’EVRAS, mais la vigilance reste de mise
La Cour constitutionnelle a débouté les opposants à l’EVRAS (Éducation à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle), validant sa conformité aux principes de neutralité de l’enseignement, de respect de la vie privée et de liberté de conscience. Pour la Cour, l’EVRAS constitue un enseignement neutre et pluraliste, sans visée d’endoctrinement. Le Centre d’Action Laïque salue une décision qui conforte le droit de tous les élèves à bénéficier de cette éducation, jugeant sa généralisation nécessaire et proportionnée à la protection des droits des enfants.
Cependant, cette victoire juridique ne marque pas la fin des tensions. Le Centre d’Action Laïque alerte sur la persistance d’une offensive réactionnaire internationale contre les droits sexuels et reproductifs. En Belgique, des collectifs comme Innocence en danger ou des associations musulmanes conservatrices instrumentalisent les recours judiciaires pour porter un combat politique et idéologique plus large, visant les acquis en matière de genre, d’avortement ou de droits LGBTQIA+. Le CAL appelle dès lors les partis démocratiques à ne pas céder à ces pressions, ni à légitimer des discours désormais désavoués par la justice.
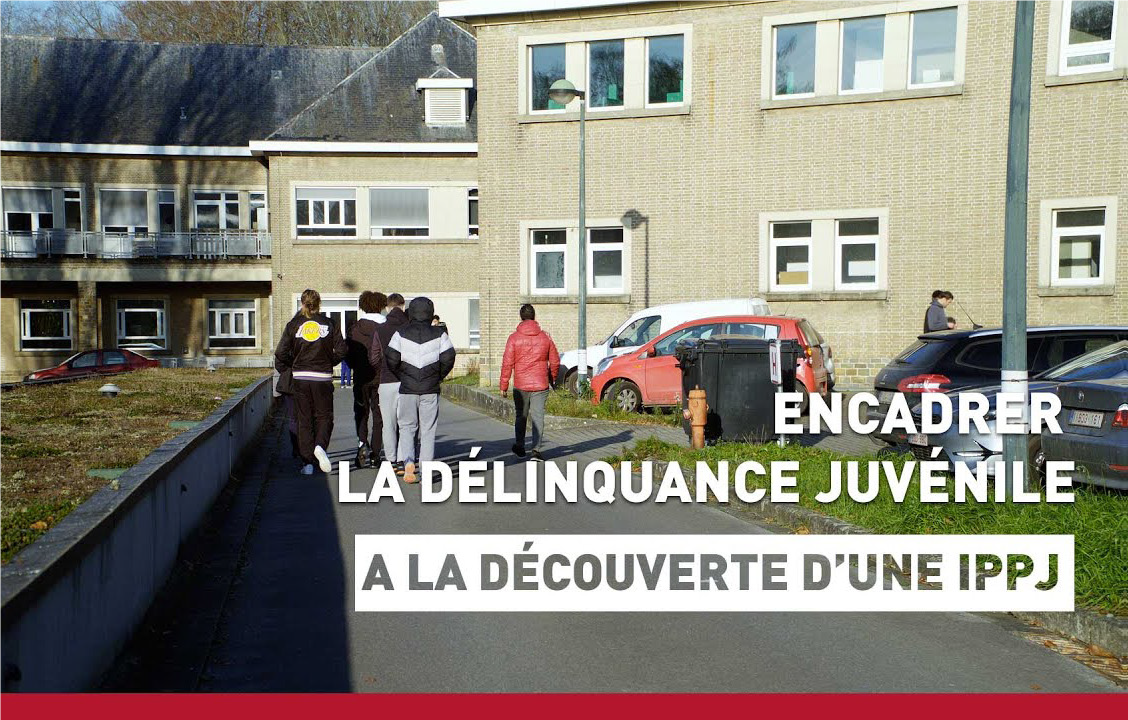
En 2023, l’équipe du CALepin a été autorisée à se rendre au sein de l’IPPJ de Wauthier-Braine. Là, une cinquantaine de mineurs délinquants sont accueillis, hébergés et encadrés afin de réfléchir aux actes qu’ils ont commis mais aussi se préparer à réintégrer la société.
(Re)découvrez notre reportage sur la chaîne YouTube de Laïcité brabant wallon : www.youtube.com/@laicitebrabantwallon9928
Entretien avec Nolan Masure, conseiller moral laïque en IPPJ – autour du film Le Paradis de Zeno Graton (2022)
Dans Le Paradis, Zeno Graton nous plonge dans l’univers méconnu des IPPJ (Institutions Publiques de Protection de la Jeunesse), à travers une histoire d’amour entre deux garçons enfermés dans ce cadre strict et clos. Une vision sensible, mais aussi sujette à débat lorsqu’on confronte la fiction à la réalité du terrain. Nolan Masure, conseiller laïque en IPPJ, partage ses impressions sur ce film et sur la réception très contrastée qu’il a suscitée chez les jeunes qu’il accompagne.
 En revoyant Le Paradis, j’ai été frappé par le regard rare que ce film pose sur un univers habituellement inaccessible, surtout à travers le prisme d’une histoire d’amour. Qu’est-ce que ce film vous a inspiré en tant que conseiller laïque en IPPJ ?
En revoyant Le Paradis, j’ai été frappé par le regard rare que ce film pose sur un univers habituellement inaccessible, surtout à travers le prisme d’une histoire d’amour. Qu’est-ce que ce film vous a inspiré en tant que conseiller laïque en IPPJ ?
NM : J’ai un avis très mitigé. C’est toujours intéressant de confronter le regard d’un spectateur extérieur, comme vous, à celui de quelqu’un qui travaille dans ces institutions. Ce film, je l’ai vu deux fois dans des contextes bien différents : une première projection entre professionnels et une deuxième avec des jeunes en sortie, dans une salle de cinéma à Namur. Ces jeunes venaient de plusieurs IPPJ, sélectionnés par leurs éducateurs.
Ce qui m’a marqué, c’est que la majorité d’entre eux sont complètement passés à côté du message du film. Ils ont focalisé leur attention sur les scènes de violence, sur l’environnement, et surtout sur le fait que ce qu’ils voyaient à l’écran ne correspondait pas du tout à leur réalité. Pour eux, ce n’était tout simplement pas une IPPJ.
Ces jeunes n’ont pas du tout vu le film comme une histoire d’amour ?
NM : Exactement. Le propos principal – cet amour interdit entre deux jeunes garçons, dans un lieu de privation de liberté – est passé au second plan. Ce qu’ils ont retenu, c’est la différence de traitement : « Ils ont plus de libertés, plus d’infrastructures, c’est dégueulasse. » C’est ce qui a suscité le plus de réactions. En ce sens, ils ont vu Le Paradis comme un miroir déformant – presque une injustice.
Et d’un point de vue professionnel, comment percevez-vous cette histoire ?
NM : C’est un bon film, indéniablement. Il est bien construit, poignant même. Mais il faut garder en tête qu’il s’agit d’une fiction très romancée. Un amour comme celui-là, tel qu’il est mis en scène dans le film, ne pourrait pas exister de cette manière dans une IPPJ. Tout est extrêmement encadré. Bien sûr, des liens peuvent se créer, des affinités, parfois même plus. Mais une relation aussi intime, vécue aussi librement, c’est presque impossible. Ou du moins, très vite interrompue par le cadre institutionnel.
Le tournage a eu lieu dans une IPPJ flamande. Est-ce que ça joue dans cette perception de décalage ?
NM : Absolument. Les IPPJ du nord du pays sont beaucoup mieux dotées en infrastructures. Ce qu’on voit dans le film – des espaces chaleureux, des ateliers modernes, des pièces de vie conviviales – ne correspond en rien à ce que nous avons en Wallonie. Chez nous, les bâtiments sont vétustes, les moyens limités. Alors forcément, quand nos jeunes voient ça, ils ne peuvent s’empêcher de comparer. Et la comparaison est frustrante.
Est-ce que ce film a tout de même une utilité, selon vous ?
NM : Oui, et c’est important de le souligner. Pour le grand public, c’est un excellent point de départ pour s’interroger sur ce qu’est réellement une IPPJ, sur ce qu’on y vit, sur ce que l’enfermement produit. Le film rend visible un lieu qu’on préfère souvent ignorer. Et rien que pour ça, il a le mérite d’exister.
Mais il faut garder à l’esprit qu’il ne s’agit pas d’un documentaire. C’est une oeuvre artistique, avec sa part de fiction et de projection. Je me demande toujours : que se passerait-il si une telle histoire d’amour survenait réellement dans notre IPPJ ? Je pense que la réaction des autres jeunes serait bien plus hostile. Et côté encadrement, on séparerait immédiatement les deux garçons, les plaçant dans des sections différentes. Ça ne passerait pas.
Sources:
1 Ils apportent une aide morale spécifique aux jeunes placés en IPPJ. Celle-ci se différencie de celle des autres professionnels tels que les psychologues, assistants sociaux et éducateurs ; elle s’exerce notamment par une présence et une disponibilité quotidiennes, le soutien à la prise en charge de la scolarité, l’organisation d’activités à thèmes, des entretiens individuels dont la confidentialité est garantie. Ils peuvent aussi jouer un rôle occasionnel de médiateur entre les jeunes, les éducateurs ou l’institution elle-même.
2 « En IPPJ, une jeunesse en quête d’identité », Nolan Masure, Espace de Libertés, Mai 2025. Disponible sur : www.edl.laicite.be/en-ippj-une-jeunesse-en-quete-didentite
3 « Et toi, t’es casé-e ? » : [Gay, lesbienne, bi, trans] dis stop aux clichés ! », disponible sur : www.ettoitescase.be
4 Le droit à l’EVRAS confirmé par la Cour constitutionnelle, CAL, mai 2025.


